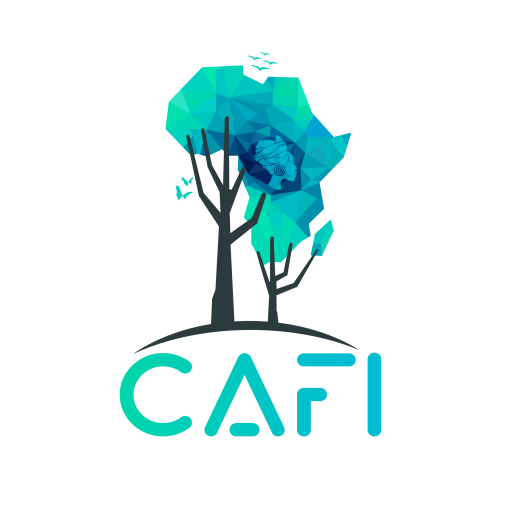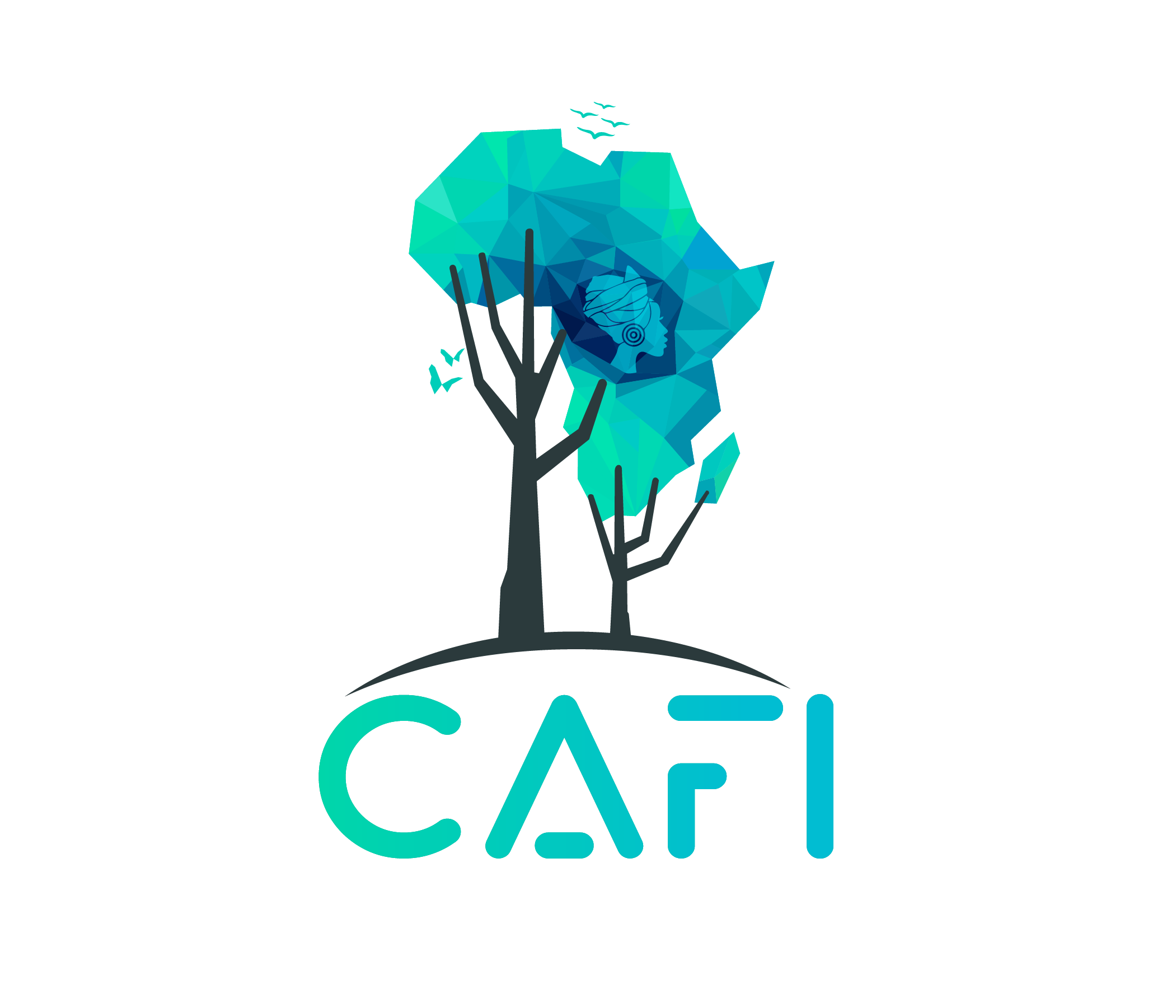-La République démocratique du Congo (RDC) est un géant de la forêt. Sa forêt tropicale, qui couvre plus de 130 millions d’hectares, est la deuxième plus grande au monde. Mais la RDC est aussi un pays économiquement vulnérable, politiquement instable et parmi les plus pauvres du monde. Une grande partie de sa population vit dans une pauvreté abjecte : 15,5 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, 2,3 millions d’enfants souffrent de malnutrition modérée et 1,1 million d’enfants souffrent de malnutrition sévère.
La forêt de la RDC est confrontée à de grands défis : la RDC est le troisième pays tropical au monde en termes de perte de forêt, après le Brésil et l’Indonésie, avec 14,6 millions d’hectares perdus entre 2001 et 2019. Mais les raisons de cette perte de forêts sont différentes : en RDC, la perte de forêts est due à la pauvreté, à un besoin local de terres et de produits forestiers (agriculture sur brûlis à petite échelle et charbon de bois) exacerbé par une forte croissance démographique. Au Brésil et en Indonésie, en revanche, la perte de forêts est principalement due au défrichement de terres forestières pour la culture de produits agricoles (tels que le soja, le bœuf, l’huile de palme).
Toute solution proposée pour enrayer la perte de forêts en RDC doit donc également se concentrer sur la réduction de la pauvreté. Concrètement, cela signifie qu’il faut trouver ensemble des réponses à des questions telles que : comment assurer la sécurité alimentaire et augmenter substantiellement la production agricole sans défricher les forêts, qui sont nécessaires pour maintenir les pluies dont dépendent les cultures ? Comment fournir des solutions de cuisson modernes et électrifier les villes dans un pays où plus de 90 % de la population n’a pas accès à l’électricité et dépend donc de la biomasse ? Comment aménager le territoire du pays, dont plus de 60% est couvert de forêts, de manière socialement équitable, écologiquement durable et en fournissant les infrastructures nécessaires à l’émergence économique ?
Forêts de la RDC
Les forêts de la RDC abritent une riche biodiversité, comme le gorille des plaines et l’Afrormosia, un arbre géant. Elles fournissent directement des moyens de subsistance à 69 % de la population du pays vivant dans les zones rurales.
L’étude régionale financée par CAFI indique une relative stabilisation de la déforestation. stabilisation relative de la déforestation entre 2016 et 2023 et une augmentation de la dégradation des forêts. Les émissions liées à la seule déforestation en RDC sont estimées à 631 millions de tonnes de CO2eq en 2023*, semblant se stabiliser par rapport aux niveaux de 2016.
hectares de forêt ont été perdus chaque année entre 2010 et 2014
%
de la population vit avec moins de 1,9 USD par jour (2018)
transférés à 22 projets par l'intermédiaire du programme FONAREDD
programmes sur le terrain et 9 programmes de réforme, de gouvernance et de suivi
%
tonnes de réductions d'émissions prévues dans le cadre des programmes provinciaux de développement rural
Nombre prévu de personnes dont les moyens de subsistance ont été améliorés grâce à nos programmes sur le terrain
La RDC a adopté sa stratégie-cadre nationale REDD+ en 2012, visant à stabiliser le couvert forestier à 63,5 % d’ici 2030, et à le maintenir par la suite. Le partenariat de CAFI avec la RDC a débuté en 2015, lorsque le gouvernement de la RDC a adopté son plan national d’investissement REDD+, sur la base duquel une lettre d’intention a été convenue pour 5 ans (2016-2020) et 18 projets ont été progressivement financés par la capitalisation du Fonds national REDD+ de la RDC (FONAREDD). En novembre 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, un accord renouvelé et élargi de 10 ans (2021 - 2031) a été signé par le Président Tshisekedi de la RDC et le Premier Ministre Boris Johnson du Royaume-Uni, débloquant des investissements de 500 millions USD pour atteindre des objectifs concrets visant à stopper la déforestation et à restaurer les terres dégradées grâce à un développement rural durable et inclusif. Le portefeuille actuel de cette deuxième lettre d’intention comprend des investissements dans l’utilisation des terres, un soutien continu à la réforme des politiques et à la gouvernance.